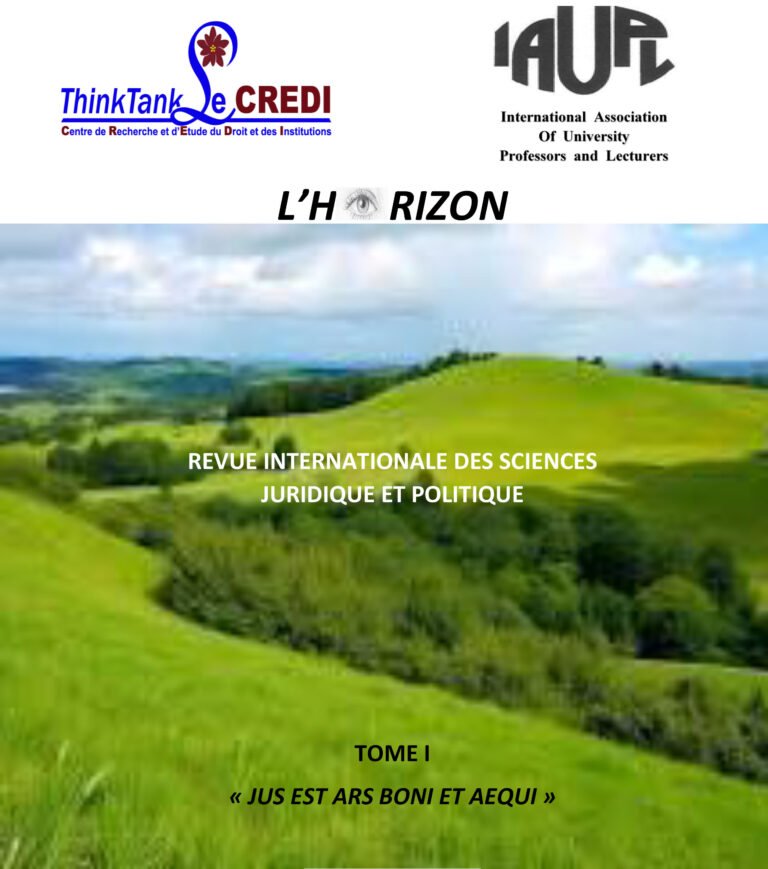ASPECT JUDICIAIRE DU MECANISME DE RECOUVREMENT DES AVOIRS ILLICITES A L’ETRANGER
Depuis longtemps, la saisie, le gel et la confiscation, en tant que moyens privilégiés menant au recouvrement des produits du crime, étaient toujours considérés comme des instruments juridiques essentiels à la lutte contre la criminalité organisée. Aussi, l’Union européenne essaie-t-elle, par exemple, de réduire, dans son territoire, les éventuels obstacles légaux à la confiscation effective des produits du crime. Elle devrait bien agir de la sorte, étant donné que selon le rapport alarmant d’Europol, au niveau européen, 2% seulement des biens ou fonds présumés issus d’activités illicites seraient gelés et ce taux baisse à 1% lorsqu’il s’agit des produits confisqués.
En fait, au niveau international, pour récupérer les biens ou fonds soustraits dans son territoire mais cachés par des criminels à l’étranger, l’Etat victime sollicite souvent à son homologue étranger de procéder à leur saisie, à leur gel ainsi qu’à leur confiscation en vue de leur restitution ultérieure. Il en résulte que la confiscation et la restitution forment le centre névralgique du recouvrement des avoirs illicites à l’étranger. Les instruments onusiens définissent la confiscation comme étant une « dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente » au profit de l’Etat. En d’autres termes, la confiscation est une décision judiciaire qui consiste à transférer à l’État, ou parfois à un établissement public, tout ou partie des biens d’une personne, à la suite d’une condamnation pénale. Dans la pratique, sauf en cas de « constitution de partie civile » directe par l’Etat requérant devant la juridiction compétente de l’Etat requis, la restitution des avoirs criminels ou illicites à l’étranger intervient la plupart du temps après leur confiscation par ladite juridiction compétente de l’Etat requis.
Par RANDRIANJAFY Solofo Théodore
Docteur en Droit privé